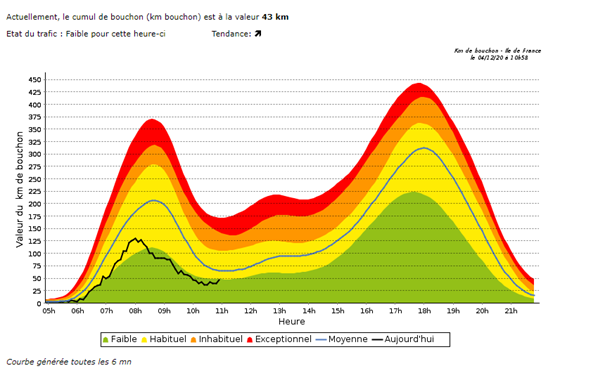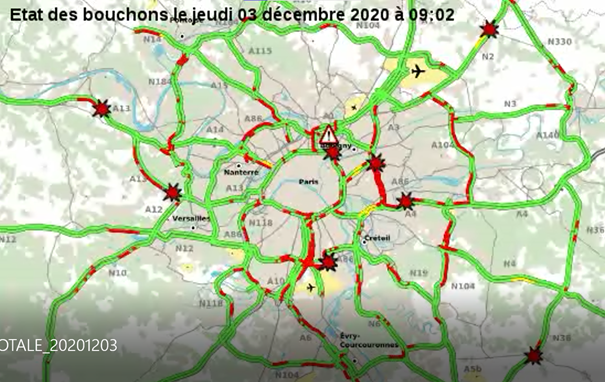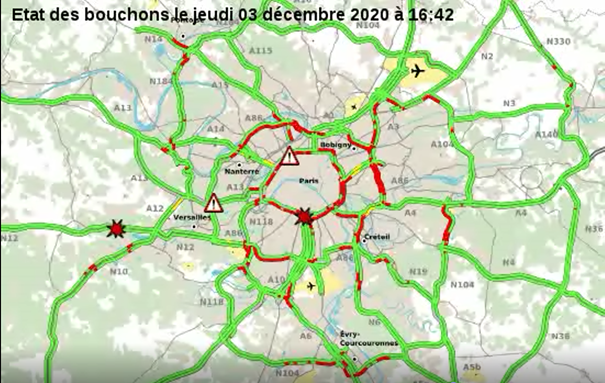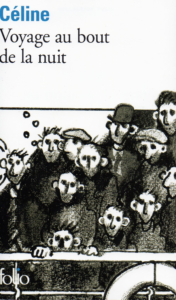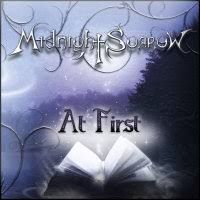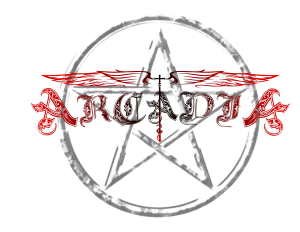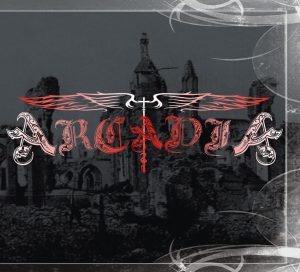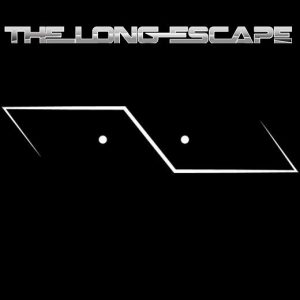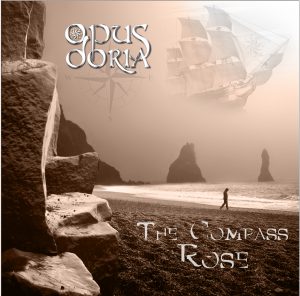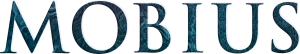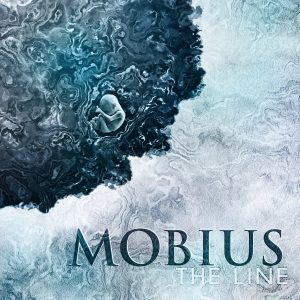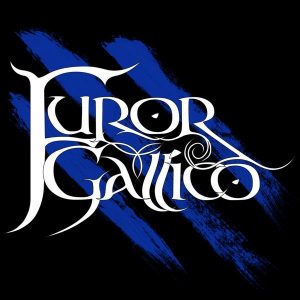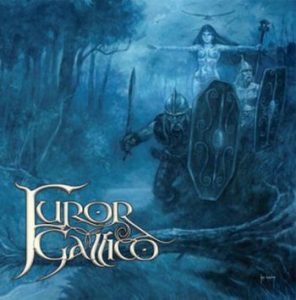Voyage au bout de la nuit
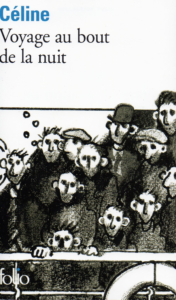
par Louis-Ferdinand Céline
Résumé
Voyage au bout de la nuit est le premier roman de Louis-Ferdinand Céline. Il est publié en 1932 en France. Il manque de peu de remporter le prix Goncourt mais glane le prix Renaudot.
L’histoire est largement inspirée de l’expérience personnelle de Céline (de son vrai nom Destouches) lors de la Première Guerre mondiale qu’il a vécue. Il la dépeint à travers les yeux d’un narrateur s’exprimant à la première personne, Ferdinand Bardamu (il reprend donc un de ses prénoms), sous l’apparence d’un« abattoir international en folie », afin de mieux décrire son absurdité. Le récit présente également la seule manière que l’écrivain estime possible d’échapper à cette guerre : la lâcheté. Il rejette donc toute idée d’héroïsme et préfère représenter la guerre par la mise en évidence de la pourriture humaine, qu’il compare avec un gant qui serait retourné et donc dévoilé de l’intérieur au grand jour. Le narrateur parcourt aussi une partie du monde, allant de l’Afrique à l’Amérique.
Le récit à la première personne débute à Paris place Clichy en 1914. On y retrouve le héros(ou plutôt antihéros), Bardamu, jeune homme au caractère rebelle. Bardamu est charmé par la musique d’une parade militaire, et s’engage dans l’armée de son pays contre les Allemands.
Il rejoint le front où il se rend compte de son erreur. Il y découvre l’horreur des combats de la Grande Guerre, ainsi que l’humiliation hiérarchique dans des batailles absurdes où se multiplient les morts, ne comprenant pas les raisons qu’il aurait de tirer sur l’ennemi.
Parmi ses compagnons d’infortune, Bardamu rencontre Robinson avec qui il projette de déserter, projet qui tombe à l’eau. Rapidement blessé, il prend mieux conscience de la mort, et il est envoyé dans un premier hôpital puis transféré dans un autre à Paris. Là, entouré de civils et de personnel soignant, il se rend compte que tout le monde participe à cette « sale guerre », ce qui renforce le caractère absurde de cette boucherie.
Sa seule envie est de fuir ; il prend conscience qu’il est lâche, mais que seule la lâcheté peut lui permettre de s’en tirer face au non-sens de la guerre. Inapte à retourner au front, il est réformé et décoré d’une médaille militaire.
Il rencontre des femmes, comme Lola, une infirmière américaine, ou Musyne. Puis Bardamu décide de partir pour les colonies en tant que gérant de comptoir commercial à Fort Gono, à bord de l’Amiral Bragueton. Après celle de la guerre, il est confronté à l’horreur de l’exploitation coloniale et à la brutalité des colons blancs.
C’est à Bicobimbo où il s’installe qu’il recroise son compagnon Robinson. Quelque temps après Bardamu tombe malade, il est atteint de folie. Il quitte donc l’Afrique« à demi-mort » pour les États-Unis à bord d’une galère espagnole. Arrivé à Ellis Island où est effectué le contrôle sanitaire des migrants, il n’est pas déclaré « sain » et se retrouve en quarantaine, puis déjoue ce contrôle en se faisant passer pour un agent compte-puces.
Bardamu erre quelque temps dans New York, pauvre et malade, où il retrouve Lola à qui il prend un peu d’argent, avant de partir pour Détroit, ville industrielle de l’automobile, où il espère travailler chez Ford. Il est embauché mais le travail à la chaîne est infernal.
C’est à Détroit qu’il rencontre Molly, jeune prostituée qui tombe amoureuse de lui. Se rendant compte de la difficulté du travail à l’usine, elle lui fait quitter Ford et l’héberge chez elle. Bardamu n’y reste pas longtemps et reprend la route pour découvrir le pays. Puis relativement déçu il rentre à Paris.
De retour en France il étudie la médecine et s’installe comme médecin à Rancy, une banlieue sale et pauvre. Il continue à vivre chichement. Mais pire est l’état de ses patients : entre leur misère matérielle, la mesquinerie de certains ou encore la cupidité, il prend conscience de la misère humaine qui est réelle, autant en France, en Afrique, qu’aux États-Unis. Bardamu vit très mal la mort de Bébert, un petit garçon atteint de la typhoïde, pour qui il avait de l’affection et qu’il avait tenté de sauver en vain, échec qui montre les limites du progrès de la médecine dans laquelle il fondait tant d’espoirs. C’est sa vision de l’homme qui en est affectée, mais aussi sa vision de lui-même.
Puis il est confronté à une histoire plus sombre encore. Robinson est de retour, et ce dernier, contre de l’argent, a accepté d’assassiner une vieille dame. Les époux Henrouille, que Bardamu connaît bien, pour hériter de la mère de l’un d’eux, décide de la faire tuer. Robinson accepte la mission et prévoit de tuer la vieille dame en faisant exploser une petite bombe. Mais il se blesse au visage et perd la vue. Les Henrouille font appel à Bardamu pour faire soigner son ami Robinson, mais aussi la vieille dame, qui doit retourner à Toulouse. Robinson l’y accompagne.
Bardamu quitte la banlieue pour travailler avec une troupe de music-hall où il est figurant. Ses aventures le mènent dans le sud de la France, jusqu’à Toulouse. Dans l’entourage de la troupe, Bardamu rencontre des prostituées puis retrouve son ami Robinson, toujours souffrant des yeux, avec qui il va vivre.
Robinson se fiance avec Madelon alors que Bardamu devient son amant. Robinson finit par achever sa mission et tue la vieille Henrouille en la poussant dans les escaliers.
Le narrateur retourne à Paris où il redevient médecin dans un hôpital psychiatrique et se lie d’amitié avec Baryton, directeur de l’établissement. Mais Baryton va mal et sombre peu à peu dans la folie. Il annonce à Bardamu sa décision de parcourir le monde dans l’espoir d’aller mieux et laisse la responsabilité de gérer son hôpital au narrateur.
Tel un leitmotiv dans la vie de Bardamu, Robinson reparaît, enfin guéri des yeux ; il ne souffre plus. Alors que Madelon et lui sont fiancés, il avoue à Bardamu qu’il ne l’aime plus, et qu’il cherche à la fuir, car elle le poursuit de sa passion amoureuse. Bardamu cache Robinson lorsqu’elle arrive. Bardamu pour sa part a retrouvé une maîtresse, Sophie, une infirmière de la clinique. Il refuse ainsi les avances de Madelon, son ancienne maîtresse, et essaie de la réconcilier avec Robinson. Pour ce faire, il organise une sortie à la fête des Batignolles tous ensemble, ce que Robinson refuse catégoriquement, exprimant toute la haine qu’il éprouve pour celle qu’il a aimée par le passé. Alors que Robinson vient avec eux finalement, Madelon lui tire dessus par trois fois au pistolet dans un taxi.
Après la mort de son ami, Bardamu sombre dans la peine, et finit au bord d’un canal. La dernière image retranscrite par le narrateur est celle d’un bateau qui siffle au loin. Bardamu l’implore de manière imagée de tout emmener, maintenant qu’il ne lui reste plus grand chose : « tout , qu’on n’en parle plus ».
Louis-Ferdinand Céline
Chronologie : Vie &
Regards sur l’œuvre
1894 : Louis Ferdinand Destouches dit Louis-Ferdinand Céline naît à Courbevoie, dans la banlieue
parisienne. Son père est un homme lettré, dessinateur satirique amateur, employé
dans une maison d’assurances, dont le propre père avait été agrégé de lettres. De
1899 à 1907, l’enfant grandit passage
Choiseul à Paris, où sa mère tient un magasin de dentelles. Élève médiocre que ses parents
destinent au commerce, il fait des séjours linguistiques en Allemagne et en
Angleterre. Il est placé en apprentissage
dans le commerce des tissus puis la joaillerie. En 1912, par devancement d’appel, il s’engage dans un régiment de
cuirassiers. En octobre 1914, alors
maréchal des logis, il fait partie
des premiers blessés au combat –
blessé au bras droit il prétendra que c’était à la tête et qu’il a été trépané.
Il est déclaré invalide à 75 %,
pose en héros dans L’Illustré national et
reçoit la médaille militaire et la croix de guerre. Démobilisé, il est affecté
au consulat français de Londres où il fréquente des milieux
interlopes. En 1916, engagé par une
société commerciale, il devient surveillant
de plantation au Cameroun pour
près d’un an. De retour en France il vit d’expédients avant de passer son baccalauréat et d’entamer à Rennes des études de médecine en 1919.
Il écrit alors des poèmes, une farce.
1924 : Ayant bénéficié de programmes allégés réservés aux anciens
combattants, Destouches termine ses études de médecine avec une thèse intitulée La Vie et l’Œuvre de Philippe
Ignace Semmelweis, qui paraîtra sous le titre Semmelweis en 1936. Il y raconte le destin tragique d’un médecin hongrois (1818-1865) qui,
anticipant Pasteur, avait préconisé le lavage
des mains au chlorure de chaux dans une maternité où il avait observé que le taux de fièvre puerpérale
augmentait en fonction de la présence d’étudiants, et que la maladie semblait
suivre leurs pas entre les salles de dissection et d’accouchement. Il rencontra
cependant l’hostilité du monde médical, fut révoqué deux fois, et même quand il
put ouvrir sa propre clinique on l’empêcha de prouver ses thèses, si bien que,
de caractère déjà irascible, il devint fou
et mourut d’une blessure qu’il s’infligea. L’auteur livre ici un récit
captivant, d’un style toutefois encore assez classique.
À l’issue de ses études, Destouches devient médecin hygiéniste pour la Société des Nations à Genève. Dans ce cadre il multiplie les missions à l’étranger : États-Unis
– où la visite des usines Ford le marque –, Cuba, Canada, Europe, Afrique. En 1927,
tout en restant affilié à la SDN, il ouvre un cabinet à Clichy, assure
des vacations au dispensaire municipal et se montre
constamment préoccupé de médecine
sociale. Il multiplie les activités en lien avec la médecine pour compléter
ses revenus. Il aurait commencé à écrire le Voyage
en 1929.
1932 : Celui qui n’est encore qu’un médecin de banlieue de trente-huit ans abasourdit la critique quand paraît, chez le jeune éditeur Denoël, Voyage au bout de la nuit sous le pseudonyme de Céline,
emprunté à sa grand-mère. Ce roman autobiographique raconte les tribulations à
travers le monde d’un certain Ferdinand
Bardamu, héros à la fois cynique
et pitoyable : il connaît
d’abord l’horreur de la Grande Guerre,
puis il passe en Afrique où il est témoin des méfaits du colonialisme sur une population quasiment réduite en esclavage. À New York il vit au plus près les
conditions de vie des émigrants, avant de se faire le témoin des procédés de
travail à la chaîne chez Ford. Revenu en France, où il s’installe comme médecin
dans une commune miséreuse, il reçoit une patientèle rongée par la
malnutrition, l’alcoolisme, souffrant de fièvres chroniques et se livrant à des
avortements clandestins. Il se fait ensuite embaucher par un hôpital
psychiatrique. Plutôt que de former une histoire continue, le récit s’égrène en
épisodes narratifs et l’œuvre se
distingue par un style innovant,
l’écrivain faisant entrer en littérature, dans des proportions jamais vues, la langue populaire, orale, de nombreux
gros mots, un argot que l’écrivain a
en partie appris avec son ami le peintre Gen Paul. La syntaxe apparaît désarticulée,
et les évocations sexuelles et scatologiques sont légion. Le héros,
tout en se faisant le porte-parole des humbles, les ridiculisent. Mais il ne
fut presque pas question de son style à la sortie de l’ouvrage, et la
communauté littéraire de tous bords trouva des raisons diverses de
l’apprécier : à gauche (Nizan, Trotski,
Aragon) on louait la critique sociale,
la mise en lumière de l’exploitation de l’homme – et un hommage à Zola rendu
par Céline en 1933 contribuera à se leurrer sur ses orientations –, et à droite (Daudet, Bernanos), on croit
lire une épopée humaniste en raison
du retour constant dans l’œuvre d’images de misère et de mort. Cette œuvre
scandaleuse, météoritique dans le ciel de l’édition française, fut donnée
favorite pour le prix Goncourt dont les jurés restèrent pusillanimes malgré les
efforts de Léon Daudet ; le prix
Renaudot apparut alors comme un lot de consolation.
1933 : Céline avait écrit la comédie satirique
en cinq actes L’Église en 1926, avant le Voyage
donc, qu’elle annonce par son contenu. En effet il y est déjà question d’un docteur Bardamu, lequel passe de
l’Afrique aux États-Unis, puis au siège de la Société des Nations à Genève et
enfin dans une clinique de la banlieue parisienne. Le héros se trouve
constamment confronté à un cynisme
général et exprime une tendresse
pour les enfants et les gens simples. Le style de Céline n’y est pas encore
tout déployé, il est encore mêlé de langue classique, mais on trouve déjà des monologues typiquement céliniens. La
pièce sera représentée à Lyon en 1936 mais Céline, qui finira par
reconnaître qu’il n’était pas un homme de théâtre, ne renouvellera pas
l’expérience.
1936 : Mort à crédit apparaît comme un antiroman d’éducation ; l’auteur y revient en effet, toujours
sur le mode de l’autobiographie romancée,
même caricaturée, fabulante, sur ses années de jeunesse dont il fait une chronique noire. Il romance notamment
ses années passées passage Choiseul
– qu’il appelle le « passage des Bérésinas » –, galerie couverte où
un Paris populaire de petits commerçants et artisans respire un air chargé de
gaz d’éclairage. Quittant l’école le tout jeune Bardamu se retrouve en apprentissage comme manutentionnaire,
puis représentant d’un joailler. Il fait ensuite un séjour linguistique en Grande-Bretagne avant de se faire bannir de
sa famille et de rencontrer un scientifique
éditeur de revue – inspiré d’Henry de Graffigny qu’avait connu Céline en
1917-1918 –, escroc qu’il suit dans
ses aventures à la campagne, où les deux hommes transforment les enfants qu’on
leur confie en sauvageons. Après le suicide de son « mentor », le
jeune Bardamu s’engage dans l’armée, et le lecteur se retrouve au début du Voyage. Toutes les expériences que fait
l’adolescent sont d’un sordide
consommé ; il se trouve exploité, volé, et même violé. Le récit extrêmement cru, au naturalisme outrancier, qui ne
délivrait plus aucun message, qui montrait du mépris même pour tous les idéaux
et ne proposait plus qu’une révolution
langagière, choqua beaucoup. La syntaxe
célinienne se délite ici en effet un peu plus, l’histoire se déployant au
gré de petites unités de sens que
séparent des points de suspension de
plus en plus fréquents. Ce phénomène s’accentuera encore avec Guignol’s Band. Le lecteur se voit sans
cesse interpelé par
l’auteur-narrateur qui cherche à l’impliquer
dans ses réactions affectives en
restituant, au gré d’une énonciation pulsionnelle,
les émotions dans une langue qui les miment au plus près. Céline propose ainsi
un nouvel art romanesque ; le
roman pour lui n’a plus vocation à émettre des idées ni même à raconter des
histoires. Et Mort à crédit apparaît comme
un chef-d’œuvre comique, poussant la
dérision et la désillusion à leur comble, en présentant un monde de l’enfance qui
n’a rien d’enchanté.
La critique qui avait apprécié ce qui
ressemblait à des dénonciations dans le Voyage
découvre ici avec surprise un stylicien
sans idéologie, signe d’un malentendu qui a perduré. C’est encore le Voyage qui est l’œuvre la plus lue, la
plus appréciée de Céline, alors que l’auteur lui-même la prisait peu, jugeant
même son style vieillot et timide. L’écrivain sera blessé par l’accueil froid
réservé à ce deuxième roman et se consacrera pour un temps à des pamphlets.
Toujours en 1936,
la même année que Retour de l’U.R.S.S. d’André
Gide, après son séjour en URSS où il est parti dépenser les droits d’auteur de
la traduction russe du Voyage, Céline
publie un premier pamphlet, très
court, Mea Culpa, au propos anticapitaliste,
antibourgeois et anticommuniste.
L’auteur développe une image noire, pessimiste de la nature humaine et de son
avenir, auquel les égoïsmes de chacun nuiront invariablement selon lui. S’y
fait jour l’idée que le communisme
aurait été engendré par un complot juif
de grande ampleur, selon une ancienne idée de droite. Ses propos contre les
peuples « négrifiés » situés « au-dessous de la Loire »
sont d’une extrême violence.
1937 : Pour certains, le pamphlet Bagatelles pour un massacre est une
tache suffisamment noire dans l’œuvre de Céline pour rayer son nom de la liste
des grands auteurs du XXe siècle. L’auteur, passionné de musique et de danse, avait écrit l’argument
d’un ballet, et ses essais infructueux pour le faire mettre en musique et
monter le font imaginer que les Juifs sont responsables de son échec. De là –
et de bien ailleurs sans doute – un flot impétueux d’insultes et de théories
présentant les Juifs comme des
croisés de nègres et de Mongols, des « Judéo-Mongols », des « sous-hommes » qui colonisent la
France et imposent leurs lois aux Français qui leur sont pourtant bien
supérieurs. Il en a également après la Russie
communiste – où l’on n’a pas voulu de son ballet –, et il se livre à
certaines digressions, notamment quand il parle, plus heureusement, des
conférences internationales.
1938 : Céline poursuit le « massacre » avec un autre pamphlet, L’École
des cadavres, continuant d’invectiver les Juifs, les Français enjuivées, les Russes communistes,
mais encore les francs-maçons, les
cocus… avec une outrance telle que des antisémites et des fascistes que les Bagatelles avaient peu dérangés en
ressentir une gêne. Il considère les tentatives d’union des Israélites, dans un contexte de
persécutions, comme une preuve de leur volonté
d’impérialisme, et son goût pour les
Allemands le pousse à regretter le démembrement de l’Empire de Charlemagne
et que la France ne soit plus unie à sa voisine. Une de ses thèses est que les
financiers juifs new-yorkais préparent une nouvelle guerre mondiale pour
s’enrichir sur le dos d’une Europe ruinée à reconstruire. Cette œuvre vaudra à
Céline et à Denoël une condamnation pour
diffamation en 1939. Céline
publiera un troisième et dernier pamphlet antisémite en 1941, Les
Beaux Draps, qui se fait l’écho de la débâcle et où s’exprime toujours sa sympathie pour les Allemands,
qui sont alors des occupants, ainsi que son mépris de la démocratie parlementaire.
Pendant la Première Guerre mondiale, Céline est
médecin à bord d’un paquebot, puis en 1940 médecin-chef du dispensaire de
Sartrouville, et enfin attaché au dispensaire de Bezons (Val-d’Oise) jusqu’en
1944. Il s’est installé à Montmartre
en 1941. S’il ne collabore pas
directement avec les nazis, il envoie des articles
violemment antisémites à des journaux collaborationnistes.
1944 : Avec Guignol’s Band, puis Le Pont de Londres (ou Guinol’s
Band II) écrit tout de suite après mais qui ne paraîtra qu’en 1964, le
héros de Céline, Ferdinand, conduit le lecteur à Londres pendant la Première
Guerre mondiale. Il s’agit d’une pongée
hallucinée dans le milieu de la prostitution
via Cascade, l’oncle d’un ami du héros, et des petits trafics, au gré de rencontres de personnages fantasques : l’acolyte de Ferdinand, Boro, un
chimiste fasciné par les engins explosifs ; un prêteur sur gages obsédé de
musique s’habillant à l’orientale ; un général envisageant de se
lancer dans la production de masques à gaz, etc. Bardamu tombe également follement
amoureux d’une adolescente. Le tout semble procéder, souvent, d’un délire alimenté par la drogue et l’alcool. Le style de Céline s’affute encore, entre exagération, burlesque et amertume.
À la mi-juin
1944, devant la défaite imminente de l’Allemagne et avec l’intention de
rejoindre le Danemark, pays neutre où il a fait virer de l’argent, Céline part
avec sa femme – Lucie Almanzor dite Lucette, épousée en troisième noce l’année
précédente – pour Baden-Baden avant
d’arriver en octobre à Sigmaringen,
où se retrouvent le gouvernement français en fuite et nombre de collaborateurs ;
ils y restent cinq mois. Il rejoint Copenhague
en 1945 et suite à une demande
d’extradition de la France il se retrouve incarcéré quatorze mois durant.
Libéré en 1947, du Danemark, il entreprend des démarches pour se trouver un nouvel éditeur, via Jean Paulhan et
Pierre Monnier, jeune admirateur de son œuvre. Il se démène aussi pour être
innocenté des accusations de trahison qui pèsent sur lui.
1949 : Casse-pipe, texte inachevé qui devait offrir une suite à Mort à Crédit, paraît grâce à la maison
d’édition créée par Pierre Monnier exprès pour publier Céline. On retrouve
ainsi Ferdinand qui, comme il l’annonçait à la fin du roman, s’est engagé, et l’auteur
s’attache ici à caricaturer la vie militaire en reconstituant la première nuit d’une jeune recrue à la caserne, en décrivant les marches lugubres au pas cadencé, la bêtise de sous-officiers soûlards, multipliant les longs monologues rageurs.
En 1950,
l’écrivain est condamné par la cour
de justice de la Seine pour « actes de nature à nuire à la défense
nationale » et déclaré en état
d’indignité nationale. Il est amnistié
par le tribunal militaire en 1951,
en raison de son statut d’ancien combattant, et revient en France très marqué
physiquement par les épreuves endurées. Il acquiert un pavillon à Meudon où il continue
de pratiquer la médecine. Il y vivra jusqu’à sa mort avec son épouse, entouré
de nombreux chiens.
1952 : Féerie pour une autre fois raconte le séjour dans les geôles
danoises qu’a fait Céline entre 1945 et 1947. Ici Bardamu se fond dans
l’auteur, devenu lui-même plus explicitement personnage. Se sentant délaissé,
meurtri, trahi même, Céline fait alterner son texte entre rêveries, délires, fantômes et hantises. Il parle de ses conditions de détention, des quelques
mois avant son départ de Paris, alors qu’il pratiquait encore la médecine à son
appartement de la butte Montmartre, de la jalousie des autres écrivains à son
égard. Le roman, première œuvre de Céline à paraître chez Gallimard, où lui a été fait un pont d’or, sera un échec critique et public.
1954 : Le deuxième tome de Féerie pour une autre fois, intitulé
Normance
sur la pression de son éditeur, décrit d’une manière très vivante, hallucinée,
un bombardement qu’a vécu Céline
dans son immeuble montmartrois, rue
Girardon. Il se compare dans l’œuvre à Pline l’Ancien rendant compte de l’éruption
du Vésuve. Au début du roman, il subit une chute, et tout le reste du texte est
marqué par son délire, souvent paranoïaque, car il pense que les gens
autour de lui veulent l’agresser. Sont présents sa femme Lili, son chat Bébert,
un fort de la halle appelé Normance, ainsi que le cul-de-jatte Jules, réfugié
au sommet du Moulin de la Galette, qui paraît à Céline orchestrer le
bombardement des forces alliées et que l’écrivain insulte copieusement. De
nombreuses redites marquent le
roman, mimant la répétition des bombes
que Céline présente aussi bêtes que les hommes. À nouveau l’œuvre paraît dans
l’indifférence générale. L’œuvre de
Céline, sans thèses et sans idées, fondée sur l’élaboration
d’une « petite musique »,
apparaît à contre-courant alors que la littérature engagée et l’existentialisme
font la une de l’actualité littéraire.
La même année paraissent dans La Nouvelle Revue française (en volume
l’année suivante) les Entretiens avec le professeur Y. Il
s’agit d’une interview fictive entre
l’écrivain Céline et le « professeur Y », censé mener l’entretien mais
qui, caricature d’un agrégé de lettres, particulièrement anxieux, est constamment
moqué par Céline. Plus loin dans l’interview il s’avèrera franchement paranoïaque :
il serait en réalité le « Colonel Réséda » et sujet de persécutions. Convaincu
par son entourage, Céline déclare avoir décidé de se vendre le temps d’une
interview – et réellement, l’ouvrage fait partie d’une stratégie publicitaire, d’une entreprise d’explication de son œuvre et de réhabilitation
–, pour susciter un engouement nouveau autour de sa personne ; et
Céline de vanter son génie, dont il
s’est rendu compte un jour qu’il était dans le métro dit-il, son invention de « l’émotion,
prétend-il, dans le langage écrit » ; et de critiquer l’avide Gaston
Gallimard, les gens de l’édition, La Nouvelle Revue française, ses concurrents – des conformistes, des jaloux – ; et de se présenter en artiste persécuté, incompris
de son vivant, et dont les générations suivantes se serviront comme modèle. Il
déplore de manière générale le sort réservé à la littérature, aux artistes méconnus
de leurs contemporains ne pouvant vivre de leur plume. Il invite en outre les
écrivains à se laisser influencer par le cinéma,
et parle de l’usage de l’argot ou
encore de l’amour.
1957 : Céline entame ce qu’on appelle sa « trilogie allemande », qui suscite à nouveau l’intérêt du
public et des critiques, avec D’un château l’autre. Il est
interviewé à la radio et passe même à la télévision. Dans ce premier volume, après
avoir, comme de coutume, fustigé les
éditeurs avides – qui le forcent à
écrire, et auxquels il obéit puisque sa patientèle, pauvre, ingrate, ne suffit
pas à le faire vivre –, l’intelligentsia
– Sartre (lequel a fait, en 1948, l’objet du court pamphlet À l’agité du bocal), Aragon, Malraux,
Maurois ou Morand en prennent pour leur grade –, Céline raconte sa fuite de Paris lors de la Libération,
puis ses séjours « d’un château l’autre », c’est-à-dire à Sigmaringen puis dans une forteresse-prison danoise. À
Sigmaringen, il est accompagné par toute une foule de Français représentative
de la France collaboratrice, et Céline de livrer des portraits féroces de personnages
historiques – Pétain et Laval au premier chef –, de décrire leur grotesque, leur mesquinerie, leur vanité,
le pitoyable de leur situation et l’insalubrité régnante en ces lieux, si
bien que la coutumière outrance célinienne verse dans un burlesque de farce.
1959 : Intrus dans l’œuvre de Céline, mais peut-être révélateur de l’être
profond de l’écrivain, les Ballets sans musique, sans personne, sans
rien apparaissent comme un ouvrage guilleret
grâce auquel on peut imaginer à quoi auraient ressemblé les arguments de
ballets de Céline une fois mis en musique et montés. S’il s’y montre misanthrope, c’est avec malice, et s’y
font jour un caractère affable et un goût conservé pour la féerie.
1960 : Nord, deuxième volée de la trilogie allemande, raconte la fuite de Paris de Céline avec sa femme
Lili et son chat Bébert, pour Baden-Baden,
puis Berlin où ils sont les seuls
occupants d’un hôtel délabré tenu par un paysan sibérien. Le trio intègre
l’acteur La Vigue, rencontré au bureau des visas, et Céline se résout à trouver
refuge chez une vieille connaissance qui le fait vivre confortablement dans un
vaste souterrain, avant que cet ami ne le case à la campagne, dans un hameau où
les Français sont traités en parias et où règne la faim. Puis l’écrivain finira
par rejoindre le Danemark. À nouveau les descriptions d’un univers en ruines, grotesque,
alternent avec les plaintes de
l’écrivain se sentant trahi, irrité du sort qu’on lui a réservé à l’issue
du conflit.
1961 : Louis-Ferdinand Céline meurt
à soixante-sept ans à Meudon d’une congestion cérébrale. Il venait de terminer Rigodon,
troisième et dernier volet de sa trilogie allemande, où il raconte son trajet vers Copenhague, d’une gare ravagée, d’un train délabré l’autre, évoquant ses compagnons de route éphémères – un docteur grec et une sœur en
charge d’un groupe de lépreux, un cortège d’enfants handicapés mentaux qui lui
sont confiés par une Française agrégée d’allemand –, entrecoupant constamment
le récit de ses plaintes de 1960, prophétisant le déferlement des Chinois sur la France et la disparition de la race blanche avec la complicité des religions
établies.
Céline se défendait de vouloir faire passer des
idées dans ses romans, il comptait seulement s’adresser à l’affectivité de ses lecteurs, en lui présentant un monde absurde, burlesque et pathétique,
à rebours de tout point de vue rationnel, de tout réconfort intellectuel. Depuis
les années 1970 principalement, la critique universitaire s’est saisie avec
passion de son œuvre. Écrivain infréquentable
et irritant pour les uns – une
partie de ses textes reste interdite de publication –, conteur et stylicien de
génie pour les autres, parfaitement représentatif d’une époque irrationnelle, excessive et brutale,
Céline, surtout insaisissable, n’a
pas fini d’être tour à tour aimé et haï.
« Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux
gens-là tiraient, les Allemands aussi peut-être qu’ils savaient, mais moi,
vraiment, je ne savais pas. Aussi loin que je cherchais dans ma mémoire, je ne
leur avais rien fait aux Allemands. J’avais toujours été bien aimable et bien
poli avec eux. Je les connaissais un peu les Allemands, j’avais même été à
l’école chez eux, étant petit, aux environs de Hanovre. J’avais parlé leur
langue. C’était alors une masse de petits crétins gueulards avec des yeux pâles
et furtifs comme ceux des loups ; on allait toucher ensemble les filles
après l’école dans les bois d’alentour, et on tirait aussi à l’arbalète et au
pistolet qu’on achetait même quatre marks. On buvait de la bière sucrée. Mais
de là à nous tirer maintenant dans le coffret, sans même venir nous parler
d’abord et en plein milieu de la route, il y avait de la marge et même un
abîme. Trop de différence. »
Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932
« Encore une journée de
perdue ! Salie ! gâchée ! pervertie absolument ! anéantie
en cafouillages !… En crétines angoisses !… C’est que je puisse
me recueillir !… Véritablement… Enfin ! que je puisse m’abstraire !…
tu comprends ?… La vie extérieure me ligote !… Elle me
grignote ! Me dissémine !… M’éparpille !… »
« Souvent j’en croise, à présent, des indignés qui ramènent…
C’est que des pauvres culs coincés… des petits potes, des ratés jouisseurs…
C’est de la révolte d’enfifrés… c’est pas payé, c’est gratuit… Des vraies
godilles…
Ça vient de nulle
part… du Lycée peut-être… C’est de la parlouille, c’est du vent. La vraie
haine, elle vient du fond, elle vient de la jeunesse, perdue au boulot sans
défense. Alors celle-là qu’on en crève. Y en aura encore si profond qu’il en
restera tout de même partout. Il en jutera sur la terre assez pour qu’elle
empoisonne, qu’il pousse plus dessus que des vacheries, entre des morts, entre
les hommes. »
Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit, 1936
« Le malheur en tout ceci, c’est qu’il n’y a pas de peuple, au
sens touchant où vous l’entendez, il n’y a que des exploiteurs et des
exploités, et chaque exploité ne demande qu’à devenir exploiteur. Le
prolétariat héroïque, égalitaire, n’existe pas. C’est un songe-creux, une
faribole, d’où l’inutilité, la niaiserie écœurante de toutes ces imageries
imbéciles, le prolétaire en cotte bleue, le héros de demain et le méchant
capitaliste repu à chaîne d’or. Ils sont aussi fumiers l’un que l’autre. Le
prolétaire est un bourgeois qui n’a pas réussi. Rien de plus, rien de
moins. »
Louis-Ferdinand Céline,
Lettre à Élire Faure, juillet 1935
Analyse
Le livre suscita de nombreuses polémiques à sa parution. Même si cela n’est pas encore totalement affirmé, l’auteur utilise à l’écrit le langage dit « oralisant » et l’argot, en jetant les bases d’un style qu’il nomme son « métro émotif». Céline refuse d’utiliser le langage classique, la langue académique des dictionnaires, qu’il considère comme une langue morte. C’est l’un des tout premiers auteurs à agir de la sorte, avec une certaine violence, et ce dans toute son œuvre.
Par ailleurs, le langage parlé côtoie le plus-que-parfait du subjonctif dans une langue extrêmement précise. L’utilisation de la langue parlée n’est donc en rien un relâchement, mais juste une apparence de relâchement. Le narrateur est plongé dans le monde qu’il décrit, d’où la symbiose apparente de son style avec celui des personnages, qui appartiennent presque tous aux populations des faubourgs et parlent de façon argotique. Mais en tant que descripteur de l’absurdité du monde, le langage parlé se doit aussi de faire preuve d’une grande précision. Si l’argot, les dislocations et autres thématisations gagnent en noblesse chez Céline, le plus-que-parfait du subjonctif ou le lexique soutenu ne le cèdent en rien. Ils se côtoient, parfois, dans une même phrase.
Le style littéraire de Louis-Ferdinand Céline est souvent décrit comme ayant représenté une « révolution littéraire ». Il renouvelle en son temps le récit romanesque traditionnel, jouant avec les rythmes et les sonorités, dans ce qu’il appelle sa « petite musique ». Le vocabulaire à la fois argotique influencé par les échanges avec son ami Gen Paul ainsi que le style scientifique, familier et recherché, est au service d’une terrible lucidité, oscillant entre désespoir et humour, violence et tendresse, révolution stylistique et réelle révolte (le critique littéraire Gaëtan Picon est allé jusqu’à définir le Voyage comme « l’un des cris les plus insoutenables que l’homme ait jamais poussé »).
Néanmoins, Voyage au bout de la nuit constitue bien plus qu’une simple critique de la guerre. C’est à l’égard de l’humanité entière que le narrateur exprime sa perplexité et son mépris : braves ou lâches, colonisateurs ou colonisés, Blancs ou Noirs, Américains ou Européens, pauvres ou riches. Céline n’épargne véritablement personne dans sa vision désespérée et, pour son personnage principal, rien ne semble avoir finalement d’importance face au caractère dérisoire du monde où tout se termine inéluctablement de la même façon. On peut y voir une réflexion nihiliste.
Personnages
- Ferdinand Bardamu : le narrateur
- Léon Robinson : son ami, presque son double. Il apparaît dans les moments décisifs, et le livre s’arrête quand il disparait.
- Alcide : son collègue en Afrique
- Lola : une américaine rencontrée à Paris et retrouvée à Manhattan
- Musyne : une violoniste rencontrée à Paris
- Molly ; une américaine rencontrée à Détroit
- Bébert : petit garçon rencontré dans la banlieue parisienne
- La tante de Bébert
- La famille Henrouille (la bru, son mari et sa belle-mère)
- Parapine : chercheur à l’Institut Pasteur, médecin, et amateur de trop jeunes filles
- Baryton : psychiatre
- Madelon : amante et assassin de Robinson (et de Bardamu, à l’occasion)
- Sophie : infirmière slovaque, amante de Bardamu
- L’abbé Protiste
La vision du monde de Voyage au bout de la nuit
Quelques adjectifs peuvent qualifier le roman :
antinationaliste/antipatriotique : le patriotisme (ou le nationalisme) est, selon Céline, l’une des nombreuses fausses valeurs dans lesquelles l’homme s’égare. Cette notion est visible notamment dans la partie consacrée à la Première Guerre mondiale, au front, puis à l’arrière, où Céline s’est fait hospitaliser ;
anticolonialiste : clairement visible lors du voyage de Bardamu en Afrique, c’est le deuxième aspect idéologique important de l’œuvre. Il qualifie ainsi le colonialisme de « mal de la même sorte que la Guerre » et en condamne le principe et l’exploitation des colons occidentaux, dont il brosse un portrait très peu flatteur et caricatural ;
anticapitaliste : sa critique du capitalisme transparaît nettement dans la partie consacrée aux États-Unis, lors du voyage à New York, puis à Détroit, principalement au siège des usines automobiles Ford. Il condamne le taylorisme, système qui « broie les individus, les réduit à la misère, et nie même leur humanité », en reprenant sur ce point quelques éléments de Scènes de la vie future (1930) de George Duhamel, qu’il a lu au moment de l’écriture du Voyage. Le regard qu’il porte sur le capitalisme est étroitement lié à celui qu’il accorde au colonialisme ;
anarchiste : à plusieurs reprises, l’absurdité d’un système hiérarchique est mise en évidence. Sur le front durant la guerre, aux colonies, à l’asile psychiatrique… l’obéissance est décrite comme une forme de refus de vivre, d’assumer les risques de la vie. Lorsque Céline défend son envie de déserter face à l’humanité entière, résolument décidée à approuver la boucherie collective, il affirme la primauté de son choix et de sa lâcheté assumée devant toute autorité, même morale. Cette vision teintée de désespérance se rapproche de la pensée nihiliste.
Le roman se distingue également par son refus total de l’idéalisme : l’idéal et les sentiments, « ça n’est que du mensonge» ou bien « Comme la vie n’est qu’un délire tout bouffi de mensonges (…) La vérité c’est pas mangeable. ». La question de Bardamu et, par là même, celle de Céline, est de découvrir ce qu’il appelle la vérité. Une vérité biologique, physiologique, qui affirme que tous les hommes sont mortels et que l’avenir les conduit vers la décomposition – l’homme n’étant considéré que comme de la « pourriture en suspens6 ». C’est pourquoi l’œuvre peut apparaître comme totalement désespérée.
Thèmes abordés
Le roman aborde plusieurs thèmes :
l’errance : au cœur de ce roman initiatique. Il s’agit d’une errance à la fois physique et psychique. Par bien des aspects, le roman se rattache à la veine picaresque : un pauvre bougre est entraîné, malgré lui, dans des aventures qui le font mûrir en lui ôtant toute illusion (« On est puceau de l’Horreur comme on l’est de la volupté. »). La passivité du personnage est flagrante : il subit les événements sans vraiment y contribuer. Dès l’ouverture, le ton est donné : « Moi, j’avais jamais rien dit. Rien. C’est Arthur Ganate qui m’a fait parler. ». Engagé volontaire pour braver son ami, le héros va faire l’expérience de la guerre, de l’horreur et surtout du grotesque de l’existence. « Je ne me réjouis que dans le grotesque aux confins de la mort » (lettre à Léon Daudet). Le nom même du personnage exprime cette idée : Bardamu, littéralement mû par son barda, c’est-à-dire en errance perpétuelle et involontaire ;
la ville : omniprésente dans le roman. Que ce soit Paris, New-York, Détroit, « Rancy » ou Toulouse, la ville est l’élément central du décor. On peut rattacher le roman de Céline à ceux, contemporains, de Dos Passos (Manhattan Transfer) ou de Döblin (Berlin Alexanderplatz) ;
la pourriture : l’individu y est inéluctablement voué, qu’il s’agisse d’un pourrissement naturel (la mort naturelle ou du fait d’une maladie) ou provoqué par un événement (la guerre, le meurtre). Outre le passage consacré à la guerre, à l’Afrique, à l’Amérique, la deuxième moitié partie de l’ouvrage, presque entièrement dédiée à l’expérience médicale du narrateur dans des milieux misérables, fait ressortir les aspects de décomposition et de pourrissement de l’individu qui doit affronter les maladies, sa propre dégénérescence, des odeurs méphitiques, la putréfaction… ;
la lâcheté : l’individu est lâche par essence. S’il ne l’est pas, il ne peut échapper aux multiples menaces guerrières, ouvrières et sociétales. Céline développe donc une vision particulièrement nihiliste de la société humaine. La lâcheté permet à Bardamu de s’assumer comme déserteur dans l’épisode de la guerre, de fuir ses responsabilités aux colonies, de quitter son emploi chez Ford, de réclamer de l’argent à ses connaissances établies aux États-Unis, de fermer les yeux sur de multiples avortements (voire de les pratiquer), de feindre d’ignorer la tentative de meurtre de la grand-mère. Cependant il n’est pas lâche au point de mettre un terme à sa vie et à toute cette mascarade, ni de ne pas dire leurs quatre vérités, de manière très directe et avec beaucoup de délectation, à des personnes en plein désarroi.
Avis
Pour le lecteur qui n’a jamais lu Céline, entrer dans l’univers de « Voyage au bout de la nuit » est une expérience particulière.
Soit l’on passe les premières pages et l’on va au bout du voyage, soit l’on s’y perd tout de suite et l’on prend la première sortie de secours possible pour quitter le train.
Le style de l’auteur, décrit précédemment, a de quoi surprendre effectivement.
Mais d’un autre côté, il contribue totalement à cette immersion dans le personnage de Bardamu, qui non seulement ne nous laisse pas le choix via la narration à la première personne, mais enfonce un peu plus le principe en nous imposant ce style entre argot et français pourtant impeccable qui nous oblige a quitter notre propre personnalité pour entrer dans celle de Bardamu tout au long de la lecture.
Pour autant n’allez pas croire que la lecture du livre se limite a cet aspect des choses.
Les descriptions de Céline sont redoutables, descriptions des personnages, de faits, de la société, des lieux.
La critique est sans fard et acide, directe et incisive, que l’on soit d’accord ou pas, mais ceci est un autre débat, le monde qui nous est dépeint est cohérent selon le point de vue de l’auteur, et chaque phrase, chaque description est autant de coups de pinceaux pour peindre cette toile immense.
On a parfois envie de quitter le livre, on se perd dans des considérations difficiles à suivre tant elles semblent jaillir sans le moindre contrôle, sans la moindre modération directement des pensées de l’auteur.
C’est d’ailleurs un peu le sentiment qui prédomine tout au long de la lecture du livre, rien n’a été contrôlé, pas de modération et encore moins de censure, ce serait une aberration, presqu’une hérésie au regard du message de l’auteur.
Alors on se laisse porter par ce flot incessant, au fil de l’errance de Bardamu, car c’est bien là aussi une thématique très présente. A la différence de bien des livres où le personnage nous emmène là où il a envie d’aller, ici nous avons la sensation de suivre un personnage qui lui-même ne sait pas ce qu’il veut et où il veut aller.
Nous retrouverons souvent des expressions dans lesquelles Bardamu avoue sans complexe être le spectateur des faits et de sa propre vie, conscient de n’y jouer aucun rôle et de ne pas le vouloir surtout.
Mais malgré tout, on finit par arriver au bout du voyage, et lorsque la dernière phrase se termine, il reste un goût légèrement amer, déjà ?